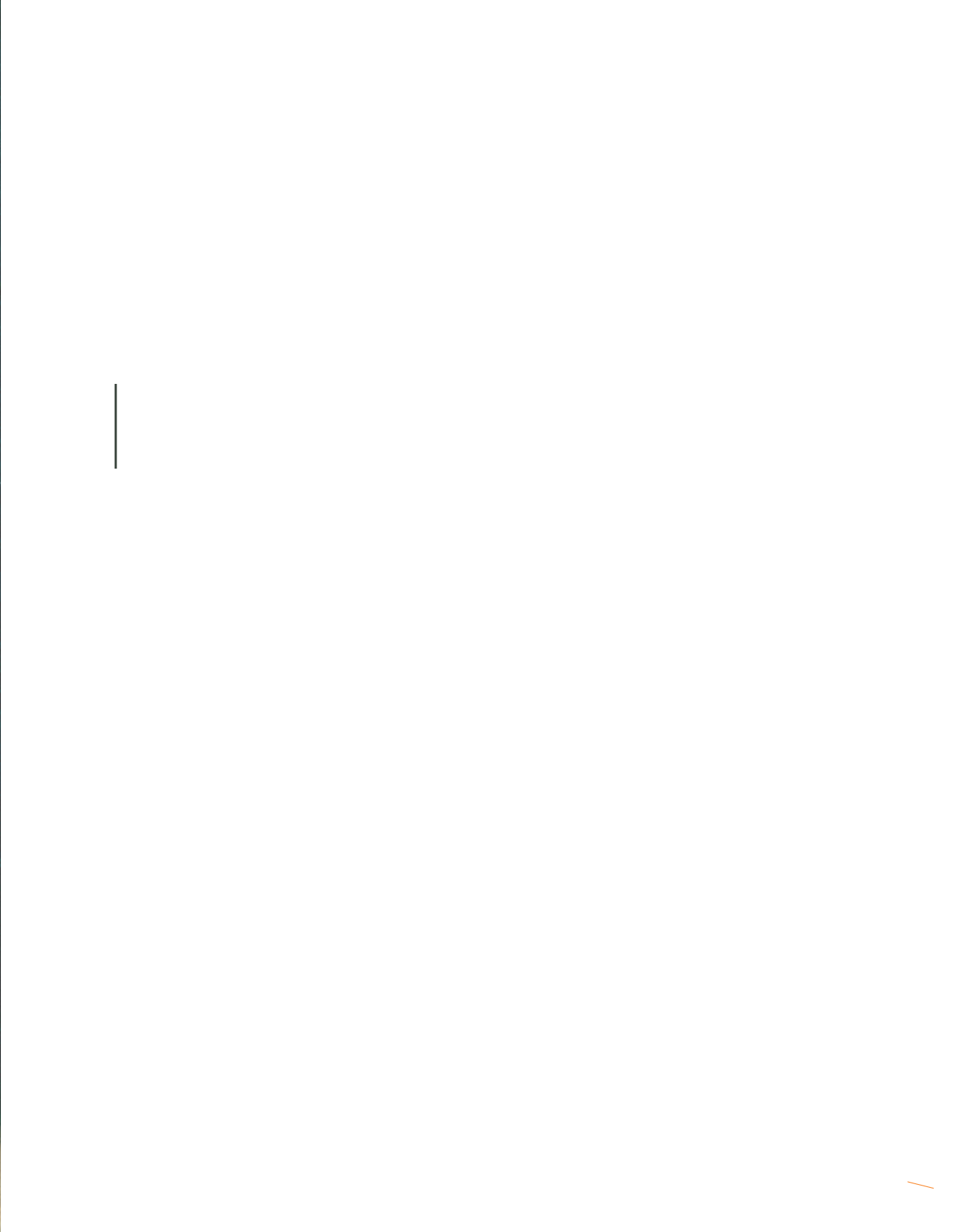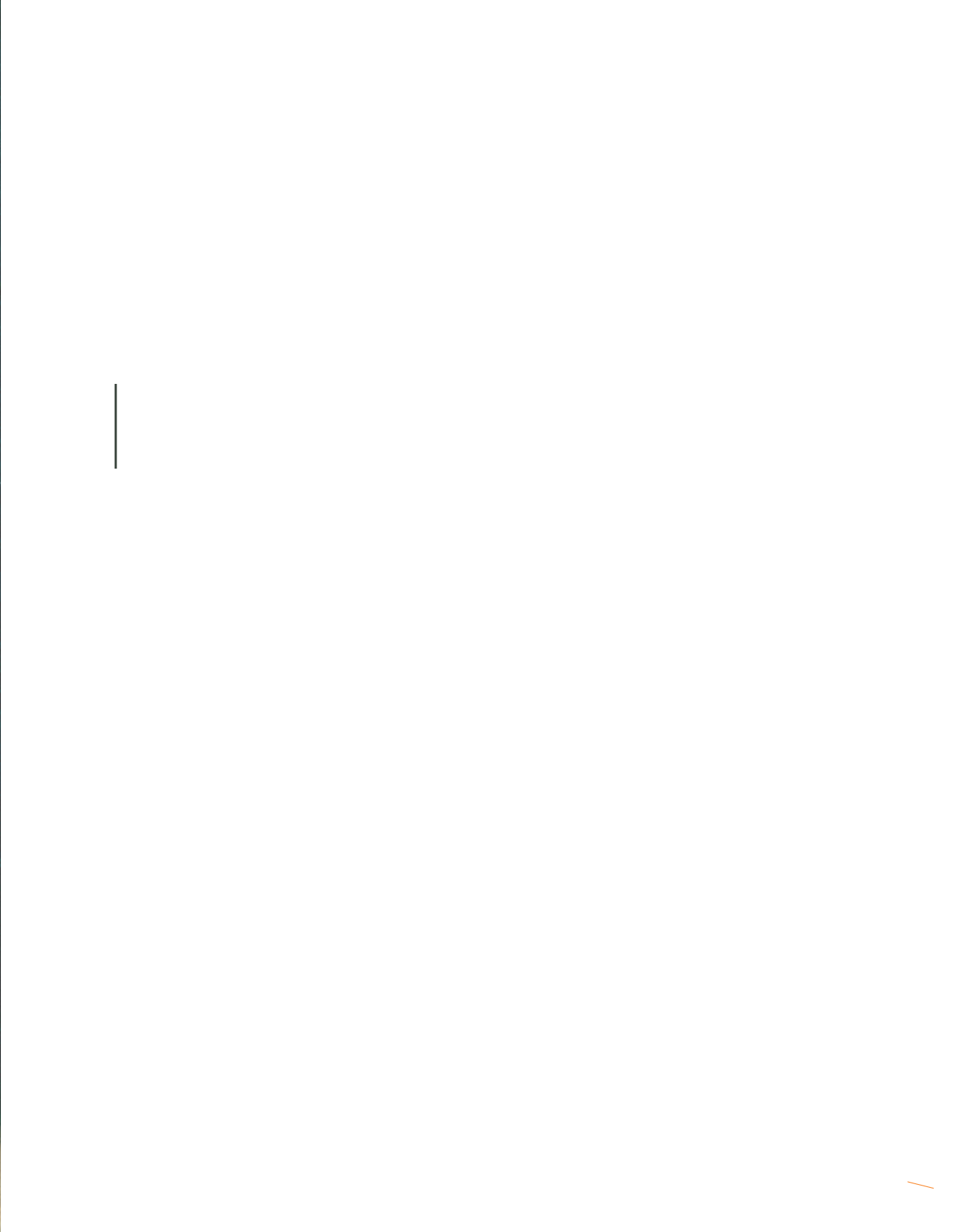
37
Portrait de l’artiste en costume oriental.
1631-1633, huile sur bois, 63 x 52 cm. Petit Palais, Paris.
Rembrandt intime
Musée Jacquemart-André, Paris
Du 16 septembre 2016 au 23 janvier 2017
Commissariat : Emmanuel Starcky, Peter Schatborn et Pierre Curie
Par Vincent Quéau
l’autre légende dorée
Rembrandt,
Malgré la fuite en avant d’une modernité souvent amnésique, Rembrandt conti-
nue d’incarner ce summum de la création du XVII
e
en superstar responsable
d’une œuvre pléthorique dans laquelle le musée Jacquemart-André a pioché
moult merveilles pour que notre automne resplendisse.
Ultime génie du Siècle d’Or s’accaparant
le ténébrisme du Caravage, Rembrandt
fascine toujours comme gourou d’une
pâte fougueuse devenue optique à force
de technique transfigurée d’un je-ne-sais-
quoi au charme magique. Or Rembrandt,
peintre avant d’être illusionniste, individu
avant d’être artisan, créateur d’une moder-
nité mieux que chef d’école, accapare
tous ces talents généralement concédés
aux apôtres de l’avant-garde. Et le plaisir
reste toujours absolu de ré-admirer, au
hasard d’un musée ou dans une exposition
monographique, si modeste soit-elle, les
sublimes ténèbres dumaître d’Amsterdam.
Cette sélection judicieuse nous permet
d’entrevoir et d’examiner l’ampleur de son
talent multi-techniques ; elle ouvre sur
une importante série de portraits gravés
à l’eau-forte qui fige devant la postérité la
physionomie de l’artiste et son entourage,
ses parents et Saskia. Tous, images sans
fards, à la rugosité âpre d’un burin ner-
veux, troquent l’idéal controuvé des gra-
veurs de la
Maniera
nordique, des Goltzius,
Wtewael, Bloemaert, contre un réalisme de
vérité, aussi acide mais délié de tout souci
d’élégance. Et cette beauté de Rembrandt,
cette capacité à engendrer le plaisir de l’œil
dans les objets les plus vils, le hisse para-
doxalement comme le portraitiste de l’âme
vivante de ses modèles. Loin de la suavité
de ses devanciers fameux, Holbein, Dürer
ou Titien, il emprunte assez peu encore à
ses contemporains ni même à la source
anversoise. L’ambiance colorée et cha-
toyante de deux tableau précoces, œuvres
de ses vingt ans – une
Scène historique
et
l
’Ânesse de Balaam
– rappelle sans ambi-
guïté ses années d’apprentissage auprès
de Pieter Lastman et pourtant, même dans
ces emprunts, la filiation semble guidée
par une autre force, signe d’un génie déjà
plus consommé ; comparons, pour nous en
convaincre, types physiques, végétations
et moirures d’une convention toute belle
et nette chez le premier, déjà fougueuse et
surprenante chez le jeune Rembrandt.
Et de fait, l’année suivante, en 1627, il troque
les jours gris de sa jeunesse contre les nuits
intenses d’une maturité précoce. Cette
métamorphose fulgurante s’observe dès la
petite
Fuite en Égypte
du musée de Tours,
dans cette matière triturée qui surnage
dans les ténèbres, ces oreilles de l’âne de
pigment et de pelage, ce chapeau de Joseph
de paille feinte mais vraie, ces plis auxquels
on croit, malgré leur abstraction gestuelle.
Le virus noctambule contracté, il ne sortira
plus de ces effets lumineux et plastiques.
Sans doute le début de carrière offre-t-il
toujours à différencier les textures et les
matières et il s’en donne à cœur joie dans
son
Autoportrait au costume oriental
: oppo-
sant les glaçures des objets de métal à la
matité du velours, au duveteux du poil du
chien, à l’irisé de la robe lamée et brodée
mais, àmesure que s’affirme son caractère,
la peinture pure se détache de l’illusion.
Devenu marque de fabrique du portrait, le
fond indéfini, brossé à la diable, souligne les