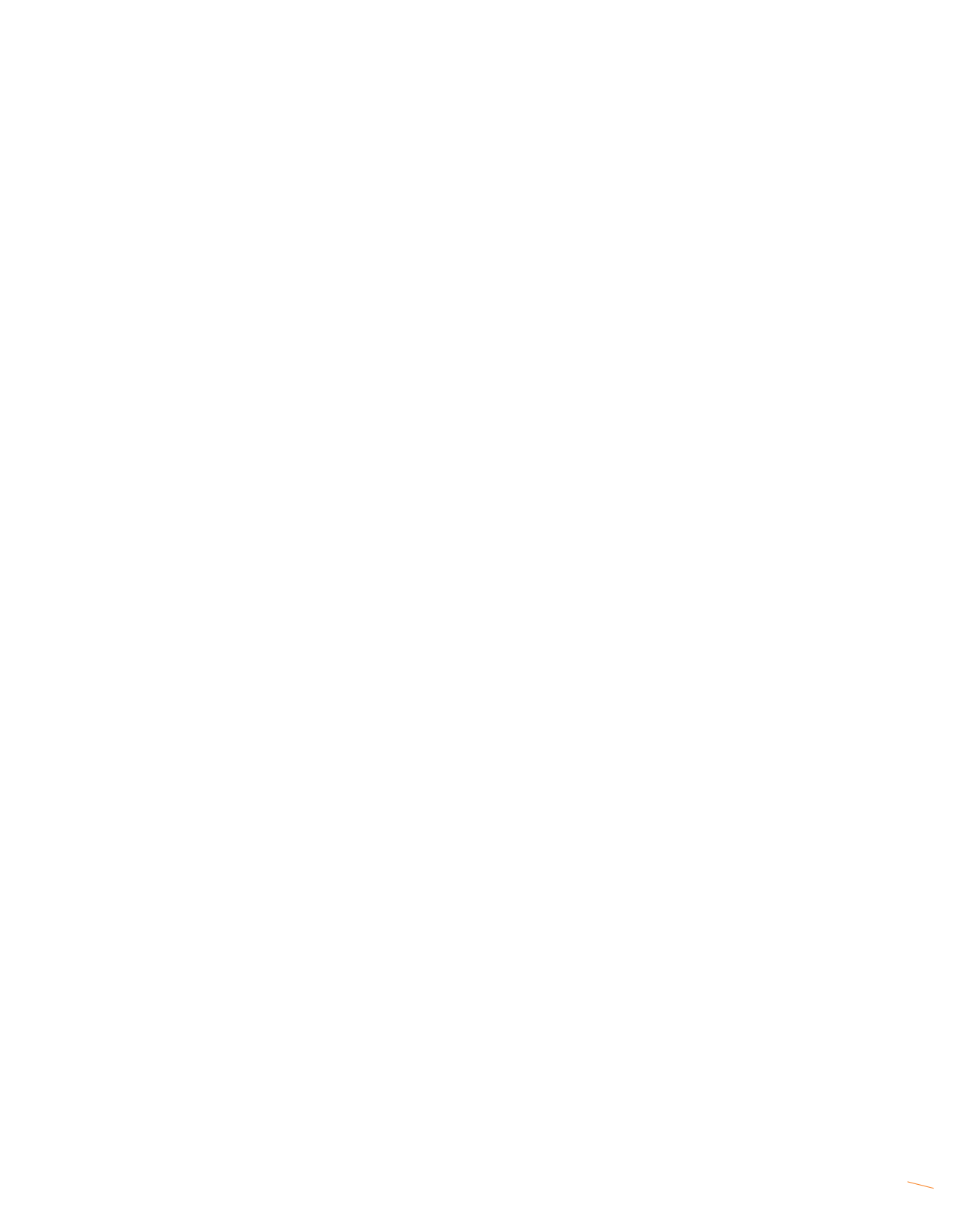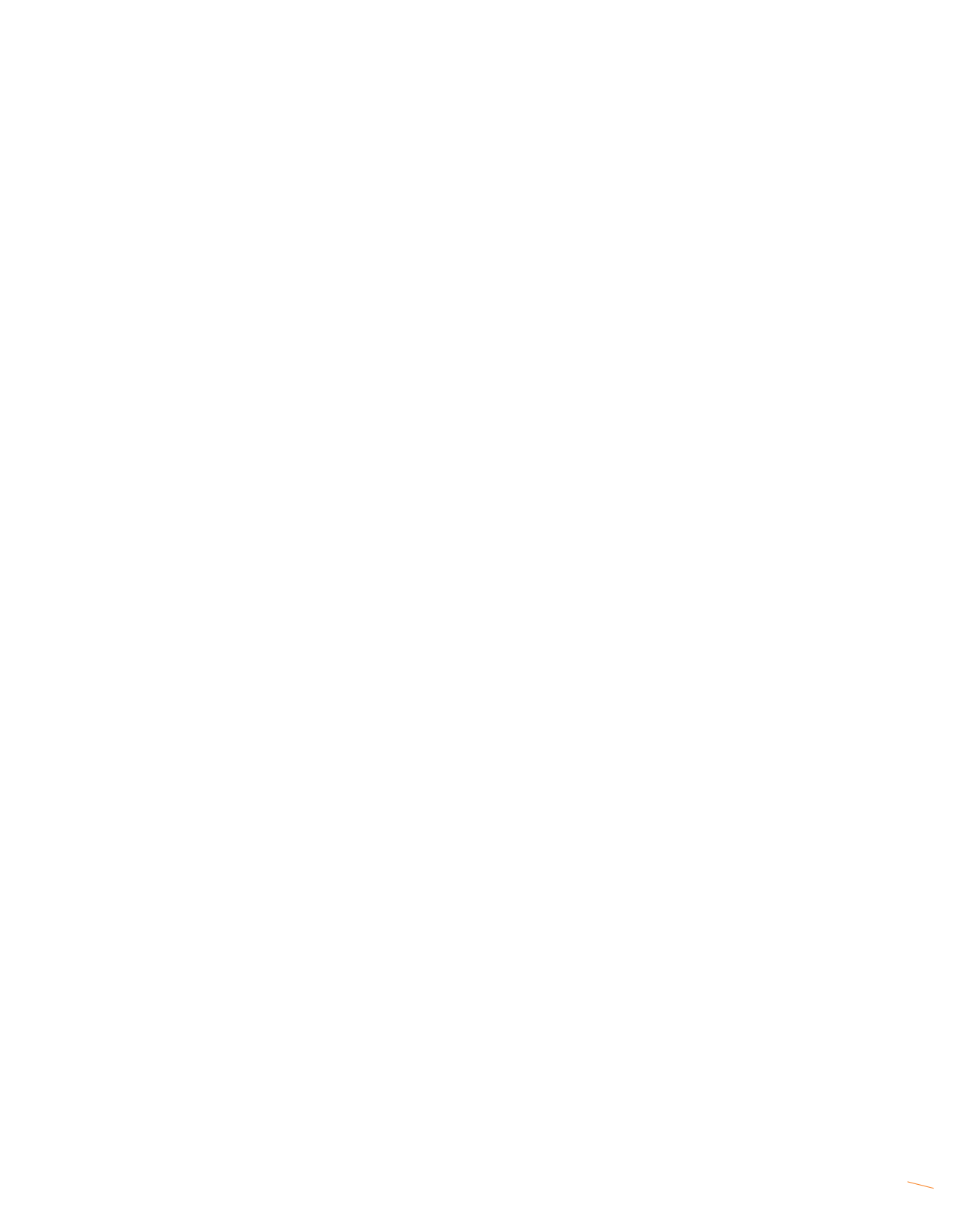
103
Entretien avec Pascal Amel
Pascal Blanchard
«Nous vivons un temps postcolonial…
et nous l’ignorons!»
Malaise dans la civilisation : que voulons-nous pour l’Europe en général et la France en particu-
lier ? Des régimes autoritaires dont l’Histoire du XX
e
siècle prouve qu’une fois au pouvoir, leur
arbitraire n’a plus de limites ? Des régimes basés sur la rationalité et traitant simultanément des
conflits extérieurs, de la sécurité intérieure, de l’éthique des grand médias dans leur traitement
des attentats, d’un « plan Marshall » pour les banlieues, d’une reconnaissance des talents issus
des minorités visibles, etc. Nous sommes à un tournant crucial du devenir de notre société, d’où
la nécessité absolue d’analyser lucidement les causes et les problématiques en jeu. Pascal
Blanchard (et quelques autres auteurs), dans son dernier opus
Vers la guerre des identités ?
aux
éditions de La Découverte, propose une grille de lecture extrêmement stimulante. Rencontre.
Pascal Amel |
Quelle fut la représentation –
d’un point de vue racial, économique,
culturel, symbolique, «exotique»… – des
« indigènes » des colonies de la France ?
Quels furent les points d’orgue de cet
imaginaire?
Pascal Blanchard |
Alors que l’immigration «exo-
tique» n’a pas encore commencé en France,
les Français découvrent pour la première
fois enmétropole, à partir des années 1870,
des « indigènes », un terme « non-juri-
dique » qui désigne alors l’ensemble des
peuples considérés par l’Europe comme
« colonisables », et
de facto
« inférieurs »
juridiquement. Ils sont exhibés dans des
spectacles ethnographiques ou des villages
coloniaux dans les grandes expositions offi-
cielles ou privées. Ce que l’on appellera
plus tard des «zoos humains» va constituer
le premier point d’orgue de cette image de
l’« exotique » colonisé et celui-ci est alors
réduit à l’image du «sauvage».
Ces manifestations se multiplient au
tournant du siècle et connaîtront un
large succès jusqu’au milieu des années
1920 avec les fameux « villages noirs »,
« nègres », ou « sénégalais » qui vont être
présentés dans plus de 80 villes françaises.
Une hiérarchisation des « races » relayée
par la presse de l’époque, les romans
populaires, mais aussi les cartes pos-
tales ou les affiches coloniales, et qui va
s’imposer pas à pas dans les imaginaires
du temps. Des images, codées à l’extrême,
mettent en scène colonisateur et colonisé.
Les visages en gros plan des personnages
noirs, par exemple, insistent sur les sté-
réotypes raciaux et accentuent l’altérité.
Les caractéristiques physiques, caricatu-
rées, sont associées à l’idée d’infériorité,
soulignée par le langage « petit nègre »,
signe « évident » de l’incapacité des Noirs
à assimiler la culture française. Pour les
Maghrébins, les images mettent en avant
le «nez sémite», le visage en partie caché,
l’aspect « fourbe» ou l’érotisme des «mau-
resques» offertes au regard des colonisa-
teurs. L’Asiatique est toujours représenté
en «masse grouillante », mais également
à travers une culture (qu’illustre le temple
d’Angkor Vat), susceptible de danger et
de révolte, et que la France a su « domi-
ner ». L’Antillais, le Polynésien ou le
Kanak occupent des espaces figuratifs aux
marges, et occupent chacun des espaces
dédiés : l’assimilé mais folklorique, le figu-
rant du paradis ou le sauvage cannibale.
Tous ces éléments constituent des récur-
rences fortes. On les retrouve tout au long
de l’histoire coloniale, mais ils se fixent au
cours de ces années fondatrices.
Un second point d’orgue s’affirme aumilieu
de l’entre-deux-guerres. La publicité à
cette époque prolonge ce regard et s’af-
firme comme le miroir de l’évolution des
archétypes sur les populations colonisées.
Après la vision racialiste de la période de
Omar Victor Diop.
Jean-Baptiste Belley
, série
Diaspora.
2014, impression jet d’encre pigmentaire sur papier Harman
By Hahnemuhle, édition de 8 ex + 2 AP, 120 x 80 cm.
Courtesy galerie MAGNIN-A, Paris.
Àvoir
Jacques Chirac
ou le dialogue
des cultures
Musée du Quai
Branly, Paris
Du 21 juin au
9 octobre 2016
Zoos Humains.
L’invention
du sauvage
La Cité
Miroir, Liège
Du 17 septembre
au 23 décembre 2016